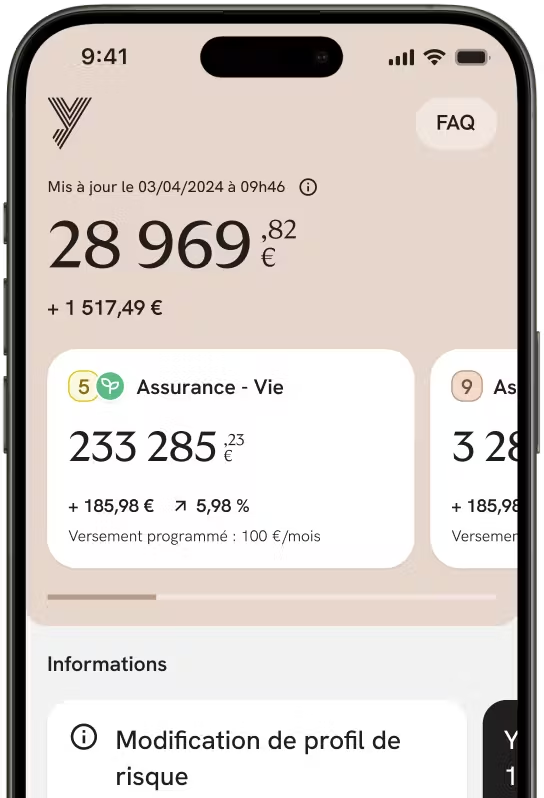Ça frémit paraît-il, la reprise se profile. Les chefs d’entreprises reprennent un peu le moral en cette rentrée. Pour s’en persuader, on évitera toutefois de se reporter aux derniers chiffres de l’INSEE, car sinon le moral risque de redescendre en flèche : 0,0% de croissance du PIB au deuxième trimestre 2016 après +0,7% au premier trimestre (Insee, informations rapides n°222, 26 août 2016) ; les deux moteurs intérieurs, la consommation (0,0%) et l’investissement (-0,2%), déjà au point mort, ne confirmant pas le léger frémissement du premier trimestre ; un léger mieux pour le solde extérieur mais entièrement dû au ralentissement des importations (-2% au deuxième trimestre), tandis que les exportations sont restées quasi-stables (-0,1%), dans un contexte de ralentissement du commerce mondial, que les analystes voient de plus en plus comme une rupture de tendance plutôt qu’un simple creux conjoncturel ; côté variations de stocks, qui nous renseignent un peu sur les débouchés que les entreprises prévoient, le fait qu’elles baissent et contribuent négativement à la croissance (-0,7 point de contribution au PIB au deuxième trimestre 2016) indique clairement que les entreprises préfèrent puiser dans les stocks existants plutôt que d’en constituer de nouveaux. En bref, les chiffres de l’INSEE ne vont pas dans le sens de la reprise. Les plus optimistes se rassureront en se disant que ces chiffres ont toujours un temps de retard et qu’ils font systématiquement l’objet de révisions conséquentes. Reste pourtant quelques raisons … de douter !
Comment pouvait-il en être autrement ?
En France, comme dans le reste de la zone euro, la politique économique, qui a été conduite dans la zone euro pour faire face à la crise, a pratiquement reposé tout entière sur la politique monétaire de la BCE. Peut-être cette dernière nous a-t-elle évité le pire – bien malin celui capable d’évaluer le contrefactuel – mais force est de constater qu’elle n’est pas parvenue à réenclencher la croissance du PIB et de l’inflation à un niveau compatible avec son objectif de stabilité des prix. Ignorant les enseignements de l’histoire économique – à chaque grande récession, la reprise a nécessité de combiner les impulsions budgétaire et monétaire - la zone euro a fait le choix de l’austérité budgétaire. Elle a, pendant la crise qui a débuté en 2007-2008, maintenu le carcan de ses règles budgétaires héritées du traité de Maastricht de 1992 et s’est refusée à définir (au-delà du mini plan Juncker) un programme commun d’investissements publics de long terme dans les secteurs indispensables à une croissance soutenable : l’éducation, la santé, la transition écologique, l’agriculture biologique, etc.
Bien que massifs, le programme étendu d’achats d’actifs publics et privés par la banque centrale européenne et ses refinancements octroyés aux banques sans limite et gratuitement (le taux directeur de la BCE se situe à 0% depuis mars 2016) n’ont pas trouvé les bons canaux pour parvenir jusqu’à l’économie réelle. Les banques n’ont pas acheminé les liquidités mises à leur disposition vers l’économie réelle, parce que les mesures dont elles ont bénéficié ont été mises en place sans assez de conditionnalité. La BCE n’a que tardivement décidé de conditionner ses refinancement à la part des crédits au bilan des banques. Et même ainsi la conditionnalité a été faible. Car ce n’est pas aux crédits passés que les refinancements devraient être conditionnés mais à ceux à venir, en définissant au préalable les crédits dont l’économie a besoin pour soutenir sa croissance. Cette définition est l’affaire de la collectivité tout entière. Les investissements dont la collectivité a besoin pour construire son avenir doivent être définis par elle, aux différentes échelles où cela est envisageable (européenne, nationale, locale). Pourquoi ne pas flécher les refinancements et achats de titres de la BCE vers les banques, publiques ou privées, qui s’engageraient à contribuer au financement de ces investissements ?
Le spectre de la stagnation séculaire
Sans la réalisation d’un vaste programme d’investissements de long terme, venant soutenir la croissance sur le même horizon, celui du long terme, nos économies ne connaîtront que des feux de pailles, au rythme des bulles spéculatives que ce soit sur le marché immobilier ou sur le marché boursier, qui gonflent la croissance à court terme et la font retomber brutalement à moyen-long terme en l’exposant à des crises financières.
Les économistes américains ont beaucoup débattu à propos du phénomène de stagnation séculaire, plus qu’en Europe où les signes sont pourtant peut-être plus perceptibles encore. Cette notion introduite par Alvin Hansen dans les années 1930 et reprise par Larry Summers en 2014 fait référence à une situation d’incapacité persistante de l’économie à garantir le plein emploi, une inflation stable et un fonctionnement stable de son système financier. C’est d’après Summers à ce phénomène que seraient confrontées les économies depuis la crise financière de 2007-2008. L’investissement productif est au point mort, son taux de rendement extrêmement bas (les estimations disponibles du taux d’intérêt naturel – qui mesure le taux de rendement du capital physique - font état d’une tendance à la baisse qui l’aurait amené à un niveau proche de 0%), la déflation reste latente. La financiarisation à outrance des économies n’est pas sans lien avec ce phénomène, en ce qu’elle a pu contribuer à détourner les liquidités de l’investissement productif, à réduire l’innovation et les gains de productivité dans la sphère productive.
De même qu’une économie où la croissance est vive ne garantit pas le bonheur de chacun, une économie qui ne croît plus ne fait pas forcément le malheur de tous. Dans les deux cas, tout dépend de la répartition des ressources disponibles. Mais si ce qui cause la stagnation est aussi ce qui alimente les inégalités, c’est bien notre mode de croissance qu’il faut changer. Pas simplement en en modifiant les indicateurs de mesure, mais en repensant ses moteurs.